Que couvre la garantie décennale ?
SOMMAIRE
- Fondement juridique et principe de la garantie décennale
- L'article 1792 : la responsabilité de plein droit
- Quels dommages déclenchent la garantie décennale ?
- Atteintes à la solidité de l’ouvrage
- Impropriété à la destination
- Éléments d’équipement indissociables
- Quand démarre la garantie décennale ?
- La réception de l’ouvrage : acte fondateur
- Un délai unique de 10 ans
- L'effet domino avec les autres garanties
- Exclusions et limites de la garantie décennale
- Désordres purement esthétiques
- Équipements dissociables
- Mauvais entretien ou usage abusif
- Force majeure et événements exceptionnels
- Procédure de mise en œuvre de la garantie décennale
- Constat du sinistre
- Notification au constructeur et à son assureur
- Expertise contradictoire
- Proposition et réalisation des travaux
- En cas de désaccord ou d’inertie
- Questions fréquentes sur la garantie décennale
- Qu'est-ce qu'un dommage décennal ?
- Qui est couvert par la garantie décennale ?
- L'obligation d'assurance vise-t-elle tous les professionnels ?
- Comment prouver qu'un sinistre relève de la décennale ?
La construction d'un logement neuf ne s’achève pas le jour où les clés changent de main : pendant dix ans, le bâti reste sous la haute surveillance d’une « assurance-vigie » : la garantie décennale.
Née du Code civil, cette protection d’ordre public oblige tout constructeur à répondre des vices qui menaceraient la solidité ou l’usage du bâtiment. Fissures béantes, infiltrations sournoises, carrelage qui sonne creux : autant de signaux que la décennale transforme en droit à réparation. Avant d’entrer dans le détail des dommages couverts et de la procédure à suivre, posons les jalons de ce bouclier juridique.
Fondement juridique et principe de la garantie décennale
La garantie décennale tire son autorité d’un noyau d’articles créés par la loi « Spinetta » du 4 janvier 1978, désormais codifiés dans le Code civil.
L'article 1792 : la responsabilité de plein droit
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur, des dommages […] qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, sauf s’il prouve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère. »
C. civ., art. 1792
La responsabilité de plein droit signifie que l'acquéreur n'a pas à démontrer une faute, il lui suffit de prouver l'existence du dommage et son lien avec l'ouvrage.
Cause étrangère : pour être exonéré, le constructeur doit démontrer que le sinistre résulte exclusivement d’un événement hors de son contrôle ; trois hypothèses, strictement appréciées, peuvent être retenues : force majeure (événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l'obligé), faute exclusive du maître d'ouvrage, fait imprévisible d'un tiers (acte d’un tiers que le constructeur ne pouvait ni prévenir ni maîtriser).
Quels dommages déclenchent la garantie décennale ?
Avant de mobiliser l’assurance décennale, il faut savoir quels maux déclenchent réellement ce « paratonnerre » juridique. La loi n’intervient pas pour une simple tache ou une panne banale ; elle réserve sa protection aux désordres qui touchent à la structure ou à l’habitabilité même du bâtiment, ainsi qu’aux équipements scellés dans le gros œuvre.
Atteintes à la solidité de l’ouvrage
Premier périmètre : tout désordre qui fragilise la structure même du bâtiment. L’article 1792 du Code civil fait ici tomber une présomption de responsabilité « de plein droit » sur le constructeur : dalle fissurée en profondeur, charpente qui se voile, balcon en porte-à-faux prêt à décrocher, affaissement de fondations. Sitôt la stabilité compromise, la décennale s’enclenche automatiquement, sans qu’il ait besoin de démontrer la faute du professionnel.
Impropriété à la destination
La loi protège également l’usage normal du bien. Infiltrations généralisées qui rendent les pièces inhabitables, isolation thermique ou acoustique défaillante empêchant toute occupation, défaut d’étanchéité d’une toiture-terrasse provoquant moisissures et dégradation du mobilier : autant de situations où l’habitation n’assure plus sa fonction. Dans ces cas, le critère d’« impropriété à la destination », toujours visé à l’article 1792, ouvre droit à la réparation intégrale pendant dix ans.
Éléments d’équipement indissociables
Le champ de la décennale englobe enfin certains équipements solidaires du gros-œuvre. L’article 1792-2 vise les dispositifs qu’on ne peut retirer sans briser la structure : chauffage par dalle intégré dans la chape, gaines encastrées qui font corps avec la maçonnerie, membrane d’étanchéité scellée en toiture. Si leur défaillance met en cause la solidité ou l’usage, elle bascule sous la garantie décennale avec la même présomption de responsabilité.

Quand démarre la garantie décennale ?
Avant de parler d’assurance et de recours, il faut d’abord savoir quand commence réellement la protection. Tout se joue le jour où l’ouvrage est « reçu » par son propriétaire : cette signature unique lance le compte à rebours des garanties légales. Comprendre ce point de départ, c’est connaître la date-butoir au-delà de laquelle la décennale cesse de jouer.
La réception de l’ouvrage : acte fondateur
Le chronomètre ne démarre qu’au jour de la réception, définie par l’article 1792-6 du Code civil comme « l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves ». Elle peut être :
- expresse, au moyen d’un procès-verbal signé entre le maître d’ouvrage et le constructeur ;
- tacite, lorsque l’occupant prend possession du bien et règle le solde sans contestation.
Cette date est déterminante : elle transfère les risques au propriétaire, clôture le contrat de construction et fait naître l’ensemble des garanties légales.
Un délai unique de 10 ans
À compter de cette réception, la responsabilité décennale court dix ans jour pour jour. Le 12 mai 2025, un logement réceptionné le 12 mai 2015 sort donc définitivement du champ de la décennale ; toute action intentée après cette échéance est irrecevable (prescription extinctive prévue par le même article 1792-6).
L'effet domino avec les autres garanties
La réception déclenche simultanément les autres garanties de la VEFA :
- la garantie de parfait achèvement (un an) qui impose au constructeur de lever toutes les réserves et de réparer tout désordre signalé au cours des douze premiers mois ;
- la garantie biennale de bon fonctionnement (deux ans) couvrant les équipements dissociables ;
- la garantie décennale (dix ans) pour les vices graves.
Une seule signature enclenche donc trois horloges : à chaque sinistre son délai et son régime de responsabilité, mais tous partent du même point zéro fixé par le procès-verbal de réception.
Exclusions et limites de la garantie décennale
La décennale n’est pas un sésame universel ; le Code civil et la jurisprudence tracent nettement ses frontières. Avant d’invoquer cette garantie, mieux vaut connaître les situations qui en sont exclues : défauts d’aspect, équipements démontables, négligences d’entretien ou catastrophes exceptionnelles.
Désordres purement esthétiques
La responsabilité décennale vise les vices qui menacent la solidité ou l’usage. Des microfissures de retrait, des variations de teinte sur un enduit ou de simples taches d’humidité superficielles n’entrent pas dans cette catégorie ; la jurisprudence les considère comme des défauts d’apparence n’affectant ni la structure ni l’habitabilité (Cass. 3ᵉ civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.437).
Équipements dissociables
Les équipements que l’on peut déposer sans briser le gros œuvre (chaudière murale, volets roulants, robinetterie) relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code civil. Sauf s’ils causent une impropriété générale à la destination, ils demeurent hors champ de la décennale.
Mauvais entretien ou usage abusif
La présomption de responsabilité cesse si le constructeur démontre que le dommage provient d’un défaut d’entretien, d’une modification non conforme ou d’une utilisation anormale par l’occupant. Un chauffe-eau entartré faute de détartrage régulier ou une fissure provoquée par la surcharge d’une terrasse relèvent alors de la responsabilité du propriétaire (C. civ., art. 1792, al. 2 : preuve d’une cause étrangère).
Force majeure et événements exceptionnels
Séisme d’ampleur exceptionnelle, inondation hors norme, glissement de terrain imprévisible : ces phénomènes extérieurs, irrésistibles et imprévisibles constituent une force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil. S’ils sont la cause exclusive du sinistre, le constructeur peut être exonéré, solution admise par la Cour de cassation lorsque le caractère hors du commun de l’événement est établi (Cass. 3ᵉ civ., 30 oct. 2013, n° 12-22.328).
Procédure de mise en œuvre de la garantie décennale
La garantie décennale n’agit pas d’elle-même ; encore faut-il enclencher la mécanique dans les règles. Du premier constat jusqu’à l’éventuel passage devant le juge, la démarche suit un itinéraire balisé où chaque courrier, chaque expertise compte. Avant de détailler les réparations, voici le mode d’emploi pour faire reconnaître un sinistre décennal et obtenir sa prise en charge.
Constat du sinistre
Dès l’apparition d’un désordre grave (fissure traversante, infiltration généralisée, affaissement), le propriétaire dresse un état précis : photos datées, mesure d’humidité, rapport d’un ingénieur, constat d’huissier si nécessaire. Ces pièces démontreront le lien entre le dommage et l’ouvrage.
Notification au constructeur et à son assureur
- Lettre recommandée avec AR au constructeur (ou promoteur), rappelant l’article 1792 du Code civil et décrivant les dégâts.
- Copie simultanée à son assureur de responsabilité civile décennale (coordonnées figurent sur l’attestation remise à la réception). Cette déclaration interrompt la prescription biennale d’assurance prévue à l’article L 114-1 du Code des assurances.
Expertise contradictoire
L’assureur mandaté contacte le propriétaire et convoque toutes les parties à une expertise contradictoire : expert assureur, constructeur, propriétaire et, s’il le souhaite, expert indépendant choisi par celui-ci.
- Objectif : déterminer la cause du sinistre, son caractère décennal et estimer le coût des réparations.
- Le rapport conclut à la prise en charge ou, rarement, à un refus motivé (par exemple cause étrangère).
Proposition et réalisation des travaux
Si la responsabilité décennale est reconnue, l’assureur du constructeur propose un programme de reprise : entreprise mandatée, calendrier, montant. Le propriétaire signe un accord écrit ; les travaux sont ensuite réalisés aux frais de l’assureur.
En cas de désaccord ou d’inertie
- Mise en demeure : relance par recommandé fixant un ultimatum.
- Référé expertise (Code de procédure civile, art. 145 ou 835) devant le tribunal judiciaire : le juge désigne un expert indépendant et peut ordonner, à titre provisoire, une provision pour réaliser les travaux.
- Action au fond si l’assureur maintient son refus : le tribunal peut condamner solidairement le constructeur et son assureur à exécuter les réparations ou à verser des dommages-intérêts.
Questions fréquentes sur la garantie décennale
Qu'est-ce qu'un dommage décennal ?
C’est un désordre qui, dans les 10 ans suivant la réception, compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination (C. civ., art. 1792).
Qui est couvert par la garantie décennale ?
Le propriétaire du bien et tous les acquéreurs successifs durant la même période de dix ans. La garantie est attachée à l’ouvrage, pas à la personne.
L'obligation d'assurance vise-t-elle tous les professionnels ?
Oui : architectes, entrepreneurs, bureaux d’études, promoteurs, vendeurs en VEFA… doivent souscrire une responsabilité civile décennale (C. assur., art. L 241-1).
Comment prouver qu'un sinistre relève de la décennale ?
Réunir photos datées, constat d’huissier ou rapport d’expert puis notifier, par recommandé, le constructeur et son assureur. L’expertise contradictoire confirmera le caractère décennal.


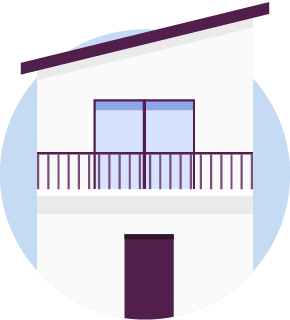
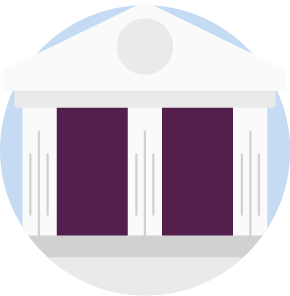





 Sophie Castella
Sophie Castella







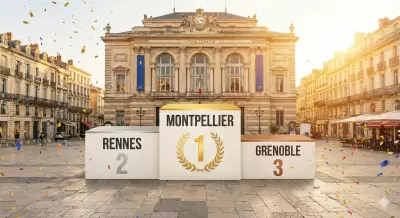




Commentaires à propos de cet article :
Ajouter un commentaire