Taxe d'habitation : Pas de retour, mais une « contribution modeste » envisagée par François Rebsamen ?
SOMMAIRE
Suppression emblématique du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, la taxe d’habitation sur les résidences principales a disparu définitivement en 2023. Présentée comme une mesure de justice fiscale et de soutien au pouvoir d’achat des classes moyennes, cette réforme a profondément modifié l’équilibre du financement local, avec autant d’approbations que d’inquiétudes parmi les élus.
Mais voilà que le débat refait surface. Dans un entretien accordé à Ouest-France le 27 avril 2025, le ministre de l’Aménagement du territoire, François Rebsamen, a ravivé la discussion en évoquant la possibilité d’instaurer une « contribution modeste » des citoyens pour financer les services publics des communes.
François Rebsamen est le Ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation. Il avait également été missionné en 2021 par Jean Castex pour mener une commission dont l'objectif était de formuler des recommandations et solutions pour relancer la construction de logements neufs en France.
Même s’il a confirmé que la taxe d’habitation ne reviendra pas, cette suggestion a immédiatement soulevé des critiques, tant du côté du gouvernement que dans les rangs parlementaires, qui y voient une tentative masquée de rétablir un impôt défunt.
Entre communication politique, pression budgétaire des collectivités locales et enjeu d’équité fiscale, cette « contribution modeste » fait du grabuge.
Taxe d'habitation : fermeté sur la suppression
Le gouvernement n’a pas tardé à clarifier fermement sa ligne : la taxe d’habitation ne reviendra pas, sous quelque forme que ce soit. Lors de la sortie du Conseil des ministres du 28 avril, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a balayé d’un revers de main l’idée d’une « contribution modeste », en précisant que cette proposition ne correspond pas à la position du gouvernement
. Une déclaration sans ambiguïté, renforcée par les prises de parole de plusieurs membres du camp présidentiel.
David Amiel, député Renaissance, s’est montré encore plus catégorique : La taxe d’habitation, impôt injuste qui accablait les classes moyennes et les villes les moins riches, ne doit revenir sous aucune forme
, a-t-il martelé sur les réseaux sociaux. Même tonalité chez Mathieu Lefèvre, également député Renaissance, qui a ironisé sur le terme de « contribution modeste » : Il n’y a pas de contribution modeste, il n’y a que des impôts en trop
, a-t-il dénoncé, appelant à mettre l’accent sur la qualité du service public plutôt que sur l’augmentation de la fiscalité.
Cette opposition vigoureuse est cohérente avec la ligne politique. La suppression de la taxe d’habitation avait été un engagement fort du président Macron, défendu comme une mesure de justice sociale et de simplification. Revenir, même partiellement, sur cette réforme en introduisant un nouvel impôt local, risquerait non seulement d’affaiblir la crédibilité de l’exécutif, mais aussi de raviver une contestation fiscale dans un contexte économique déjà tendu.

Une « contribution modeste » : contours et objectifs flous
"On ne va pas recréer la taxe d'habitation, non. Sa suppression était une bonne décision, elle a créé un gain de pouvoir d'achat, on ne reviendra pas là-dessus"
François Rebsamen
Si François Rebsamen se veut rassurant en affirmant qu’il n’est pas question de ressusciter la défunte taxe, il est normal que l’idée de la « contribution modeste » qu’il avance fasse hausser les sourcils. Dans son entretien à Ouest-France, le ministre évoque une nouvelle forme de participation citoyenne destinée à financer les services publics communaux et à « renouer le lien entre les collectivités et les citoyens ». Mais au-delà de cette intention déclarée, le projet reste à ce jour mal défini, sans base législative ni chiffrage précis.
Le concept n’est pas nouveau : il rappelle plusieurs propositions formulées ces dernières années par d’autres responsables politiques. En novembre 2024, Catherine Vautrin, alors ministre du Partenariat avec les territoires, avait déjà évoqué une « contribution citoyenne au service public », insistant sur le fait que « rien n’est gratuit ». Le fil conducteur est clair : restaurer un sentiment de responsabilité fiscale locale, sans pour autant recréer un impôt perçu comme injuste.
Certains élus locaux ont déjà imaginé les contours que pourrait prendre cette contribution. Michel Fournier, président de l’Association des maires ruraux de France, suggérait une contribution indexée sur les revenus, rompant avec l’ancien système de la taxe d’habitation fondé sur des valeurs locatives obsolètes – certaines datant de plus de 50 ans – et jugées profondément inéquitables. Cette logique permettrait, selon ses partisans, de mieux répartir l'effort fiscal entre citoyens en fonction de leur capacité contributive réelle.
D’autres variantes ont émergé : David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Association des maires de France (AMF), plaidait en 2024 pour une « contribution résidentielle universelle », que chaque habitant – propriétaire ou locataire – paierait, avec des dégrèvements possibles pour les ménages non imposables. À l’opposé, Camille Galtier, maire de Manosque, proposait une « taxe locative », ciblée uniquement sur les locataires disposant de revenus confortables, estimant que certains propriétaires modestes sont aujourd’hui plus fiscalisés que des locataires aisés.
Réactions du terrain : des élus partagés
Si la proposition de François Rebsamen suscite des remous au sein de l’exécutif, elle ne fait pas non plus consensus parmi les élus locaux, pourtant directement concernés par la question du financement des services publics municipaux. À première vue, certains maires pourraient apparaître favorables à cette idée de « contribution modeste ». Pourtant, une fois examinées de plus près, leurs positions révèlent une divergence de fond sur les modalités et les principes.

Interrogé par Le Figaro, Emmanuel Sallaberry, coprésident de la commission des finances de l’Association des maires de France (AMF), réfute l’idée que les maires exerceraient une pression sur le gouvernement pour relancer la taxe d’habitation. C’est faux ! Nous sommes contre le retour de la taxe d’habitation et ne l’avons jamais réclamé
, insiste-t-il. Tout en rejetant le retour d’un impôt impopulaire, Sallaberry se dit néanmoins ouvert à l’idée d’une participation financière plus équitable, qui pourrait prendre la forme d’une « contribution universelle » si elle respecte des critères de justice sociale.
De nombreux édiles reconnaissent une difficulté croissante à maintenir l’équilibre budgétaire de leurs communes depuis la suppression de la taxe d’habitation. Pour certains, cette perte de recettes a été partiellement compensée par une hausse de la taxe foncière, supportée uniquement par les propriétaires. Ce déséquilibre crée un sentiment d’iniquité : comme l’a souligné François Rebsamen lui-même, être propriétaire de son logement ne signifie pas forcément être riche »
.
D'autres élus, comme David Lisnard, défendent une approche plus large : faire contribuer tous les habitants, propriétaires comme locataires, selon leur situation. Le président de l’AMF le soulignait dès 2024 : environ la moitié des habitants ne paie plus aucun impôt local
, ce qui mine selon lui le lien civique entre les citoyens et leur territoire. Il en va d’une volonté de responsabilisation collective.

Des enjeux politiques et fiscaux
Derrière les débats sémantiques entre « taxe » et « contribution », se cache une réalité budgétaire difficile à ignorer : les finances locales sont sous pression. Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, estimée à environ 18 milliards d’euros de manque à gagner pour les collectivités, l’État a certes mis en place un mécanisme de compensation, mais celui-ci est jugé insuffisant, inégalement réparti, et surtout rigide dans son évolution.
De nombreuses communes ont donc dû réagir en augmentant la taxe foncière, parfois de manière spectaculaire. À titre d’exemple, certaines grandes villes ont enregistré des hausses de 15 à 25 % en quelques années, selon les données de l’Association des maires de France. Or cette taxe pèse exclusivement sur les propriétaires, ce qui alimente un sentiment croissant d’injustice fiscale, d’autant plus marqué lorsque ces derniers sont âgés, modestes ou vivent dans des territoires ruraux.
Mais comment garantir des services publics de qualité (ramassage des déchets, entretien de la voirie, écoles, etc.) en respectant d’un même souffle l’engagement présidentiel de ne pas alourdir la fiscalité locale des ménages ? La contribution esquissée par François Rebsamen cherche à apporter une réponse à cette équation, mais elle se heurte à un double risque politique.
D’une part, une telle mesure pourrait être perçue comme un retour masqué de la taxe d’habitation, remettant en cause une réforme emblématique du macronisme. D’autre part, elle pourrait nourrir un sentiment de méfiance fiscale, dans un climat déjà tendu par l’inflation, la réforme des retraites ou les difficultés d’accès au logement.
Sur le plan fiscal, les modalités techniques de cette contribution posent également question. Doit-elle reposer sur les revenus ? Être proportionnelle ou forfaitaire ? Faut-il l’assortir d’exonérations pour les ménages modestes ? Autant de paramètres qui déterminent non seulement son acceptabilité sociale, mais aussi sa légalité constitutionnelle dans un État centralisé comme la France, où la fiscalité locale reste très encadrée par la loi.


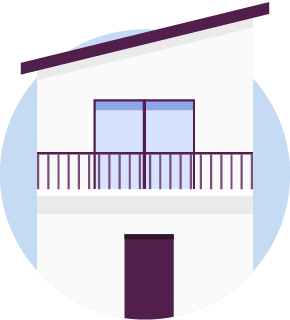
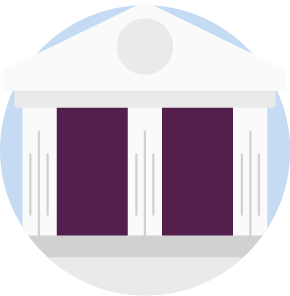





 Hervé Koffel
Hervé Koffel





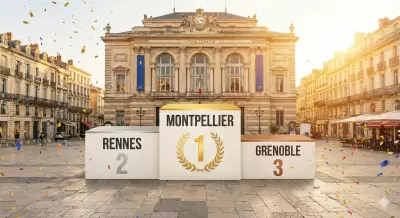





Commentaires à propos de cet article :
Ajouter un commentaire